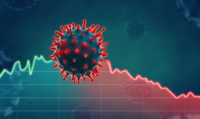États-Unis, France, Mali, … : Attention, danger
Le monde entier reste encore sous le choc d’une crise sanitaire de grande ampleur, aux contours toujours mal connus et à peine maitrisés, aux conséquences économiques inévitablement lourdes mais mal estimées. Mais trois exemples bien différents nous rappellent que le « monde d‘après » n’a pas fait table rase des dangers du « monde d’avant », bien au contraire.
Aux États-Unis, les images de l’affrontement entre une jeunesse afro-américaine, irrémédiablement pauvre et méprisée pour le plus grand nombre, soumise au risque permanent d’injustices de la part de policiers, et un pouvoir qui attise les colères au lieu de les apaiser, sont d’une violence extrême. Elles montrent bien que le racisme, spécialement anti-noir, reste une plaie historique béante dans le pays. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la première puissance économique mondiale est toujours engluée dans la crise sanitaire internationale du Covid-19, dont elle est un des pays les plus durement touchés et pour laquelle la stratégie de réponse demeure floue, ce qui en aggrave sans doute les conséquences morbides. Au plan économique, la situation est emplie de contrastes étonnants avec une forte récession économique, un nombre de chômeurs dépassant celui de la Grande Dépression et des indices boursiers qui, en trois mois, ont perdu près de 40% de leur valeur avant de regagner quasiment tout le terrain perdu. La personnalité très « spéciale » du Président contribue encore à assombrir le tableau : sa gestion souvent erratique, imprévisible et partisane, sa virulence gratuite sont des facteurs importants de la scission croissante des citoyens en deux blocs qui semblent irréconciliables à court terme. La situation apparait donc explosive jusqu’aux élections de mi- novembre, et pourrait le rester ensuite
En France, le panorama est différent mais non moins inquiétant. La pandémie du Covid-19 avait mis en évidence de sérieuses déficiences dans la gestion par le gouvernement de la situation sanitaire du pays : manque de masques et de tests difficilement avoués ; hésitations de stratégie ; méthodes inapplicables de déconfinement dans certains secteurs. Elle a cependant été aussi un grand moment de solidarité nationale, notamment au bénéfice des personnels soignants, une belle démonstration de discipline dans un confinement qui fut douloureux pour beaucoup de citadins et une manifestation du rôle essentiel de l’Etat pour amortir le choc financier issu de l’arrêt imposé de la plupart des activités. Ce sentiment de cohésion a vite été mis à mal lorsque les questions économiques et sociales ont repris le dessus. Des réformes réclamées en vain de longue date, comme celle de l’hôpital public, et soudainement apparues indispensables et urgentes ne bénéficient pas de l’élan espéré. L’inévitable repli de l’Etat dans le financement du chômage partiel, la fragilité financière de nombreuses entreprises et la progressivité de la reprise vont entrainer une explosion à court terme du nombre de demandeurs d’emploi et une diminution significative du pouvoir d’achat. Le manque de flexibilité des chefs d’entreprise comme des salariés face aux sacrifices mutuels à consentir au moins provisoirement risque de rendre la récession plus grave que dans d’autres pays européens. De fortes tensions sociales pourraient alors resurgir, créant le risque d’un nouveau mouvement de « gilets jaunes », aggravé par une poussée de colère liée à la question raciale inspirée par les évènements américains mais alimentée par divers extrémismes. Il n’est nul doute que la très forte abstention et la défaite du pouvoir aux municipales du 28 juin donnent la mesure de l’insatisfaction générale.
Au Mali, l’inquiétude est aussi à son comble. Depuis le coup d’Etat de mars 2012 et l’invasion terroriste qui l’a suivi, le pays semble avoir connu une incessante descente aux enfers. Le pouvoir mis en place en 2013 pour 5 ans n’a réglé aucun des trois problèmes cruciaux du pays. Le premier est sécuritaire. Les terroristes n’ont pu être éliminés, malgré les appuis extérieurs, notamment français, aux forces armées nationales, et se sont même installés dans le Centre du Mali. L’accord d’Alger de 2015, censé mettre fin à l’invasion, n’a produit pour l’instant que des effets mineurs. Le deuxième, politico-administratif, est celui de la mauvaise gouvernance, condamnée par tous mais plus vive que jamais. Elle entraine à la fois des déperditions considérables dans les finances publiques, le découragement de nombreux investisseurs privés nationaux ou étrangers, le ralentissement des activités. Le troisième, politique et économique, réside dans l’absence d’une stratégie cohérente et concrète de développement économique et social du pays. Faute de celle-ci, des questions cruciales comme celle de l’éducation, de la santé, d’une faible création d’emplois, de la réduction de la pauvreté, de la modernisation de l’administration restent en déshérence derrière la pression des multiples urgences, et poussent les citoyens dans la résignation ou la seule recherche d’une solution individuelle. La persistance d’une croissance économique honorable, sans transformation structurelle, ne s’est pas traduite dans une réduction des inégalités. Malgré tout, les Autorités en place ont été reconduites en 2018 après une élection tendue. Depuis lors, les résultats des élections législatives récentes ont engendré de nombreuses incompréhensions additionnelles. Dans les dernières semaines, un mouvement inédit de contestation, où se mêlent chefs religieux et leaders politiques, a demandé la démission du Président. Face à ces difficultés majeures, l’épidémie mondiale du Covid-19, apparemment peu prégnante jusqu’ici, représente un péril sanitaire mineur, mais est lourde de détériorations économiques supplémentaires.
Si ces situations différent profondément dans leur contexte, leur dangerosité et les solutions possibles, elles présentent toutefois plusieurs points communs.
Le premier est la qualité nécessaire de l’écoute de toute la nation qu’ont à incarner les plus hauts dirigeants du pays. Celle-ci doit être un mélange savant mais indéfinissable de proximité et de distanciation, d’humilité et de hauteur de vue, qui se conquiert mais reste toujours fragile dans les démocraties. Il impose que le Président n’agisse pas dans le seul intérêt de ses électeurs, d’un groupe socio-économique ou d’un clan ethnique ou familial, mais soit capable d’apprécier le bien-fondé des revendications de ceux qui ne l’ont pas élu et d’y apporter au moins un début de réponse. En l’absence d’une telle attention, Martin Luther King avait résumé ainsi l’inévitable : « Une émeute est le langage de ceux qu’on n’entend pas ». Les renversements de régime intervenus en 2019 en Algérie et au Soudan montrent que même des pouvoirs dictatoriaux peuvent s’écrouler, contrairement à toute attente, s’ils restent trop longtemps sourds et aveugles.
Le deuxième est l’impatience croissante des populations, et surtout de la jeunesse, face à des problèmes majeurs souvent dénoncés mais toujours présents, voire aggravés, tels les méfaits du racisme, le niveau élevé de chômage, l’aggravation des inégalités et la persistance d’une grande pauvreté. Faute d’une évolution positive de ces sujets sortant des questions catégorielles classiques, les partis politiques et les syndicats, déjà affaiblis, peuvent se trouver dépassés par leur inaction ou par une position déphasée face à ces revendications transversales. Dans un monde où la communication est devenue partout omniprésente, à travers des réseaux sociaux incontrôlables ou des médias parfois plus tentés par le « buzz » que par une analyse approfondie, ces insatisfactions trouvent de nouveaux champs d’expression hors des voies démocratiques traditionnelles. Elles peuvent déboucher sur des mouvements spontanés, prenant dans certains cas une dimension inattendue, qui restent souvent sans lignes directrices et essentiellement contestataires. Ceci complique la réponse qui peut leur être apportée, mais facilite en revanche leur perturbation par de nombreuses « fake news » ou leur manipulation, voire leur direction, par des tendances ou des groupes bien structurés, politiques ou religieux selon l’environnement, qui ont leurs propres objectifs et « agendas ». Cette nouvelle donne impose aux dirigeants prudence, constance, force de conviction et d’imagination que seule peut apporter la capacité d’écoute évoquée ci-avant.
Le troisième point commun est que la dégradation et les blocages s’approchent parfois d’un niveau qui dépasse les capacités normales de réforme d’un Etat, quel qu’il soit. La solution requiert alors à minima dans le pays concerné une mobilisation exceptionnelle des énergies autour d’une union nationale ou d’une réforme constitutionnelle. Pour réussir, celle-ci devrait prendre à bras le corps et selon une nouvelle approche tous les problèmes posés et viserait à transformer radicalement les règles de coexistence entre citoyens. La base des désaccords étant souvent tout à la fois économique, politique, culturelle ou sociétale, les actions à mener auront à englober deux composantes. D’abord trouver une solution d’urgence aux doléances les plus sensibles, afin de rétablir un début de confiance et une meilleure sérénité entre les parties prenantes. Ensuite, dépasser tous les égos et conduire des actions structurelles de moyen et long terme qui pourraient transformer fondamentalement le pays en établissant un nouveau « contrat de société » que s’appropriera le pays tout entier. Comme on le devine, il s’agit là d’une mission impossible si l’équipe en charge des réformes n’a pas une qualité et des méthodes de travail exceptionnelles et de grands pouvoirs de décision.
Le dernier aspect est le risque que des revendications légitimes brutalement exprimées conduisent à des poussées de fièvre sans lendemain, soit parce que ceux qui contestent auront échoué, soit parce que les changements éventuels de dirigeants n’auront pas conduit aux réponses attendues. Il est en effet moins difficile de contester que de construire un nouvel ensemble cohérent introduisant les transformations de fond réclamées. Dans les trois pays retenus comme exemples, les forces qui soutiennent les alternatives ont encore à démontrer une vision stratégique de l’avenir capable d’apporter des solutions concrètes et réalistes aux problèmes posés. En la matière, l’expérience a montré, en Afrique comme en Europe, que l’existence d’unions régionales au sein desquelles se tiendraient les pays en difficultés pouvait constituer un « amortisseur de crise » en encourageant la négociation aux dépens de l’affrontement. Cependant, ces intégrations régionales n’ont pu jusqu’ici inspirer des stratégies rénovatrices qui poseraient le futur d’un pays en crise sur de nouvelles bases.
L’allégement de la menace du Covid-19 s’est donc accompagné de la résurgence de questions cruciales déjà anciennes mais toujours d’actualité. Chacun doit souhaiter que le traumatisme créé par la pandémie produise un déclic qui permette d’introduire enfin des avancées réelles sur ces sujets. Mais cette période exceptionnelle doit aussi nous conduire à donner une importance primordiale à des problèmes comme celui de la lutte contre le réchauffement climatique ou une meilleure protection contre la reproduction de telles catastrophes sanitaires. C’est seulement si de telles actions sont devenues prioritaires, à côté de la reconstruction économique, que nous entrerons vraiment dans un nouveau monde.
Paul Derreumaux
Article publié le 29/06/2020