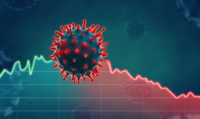Sur la route de leur développement économique, les Etats d’Afrique subsaharienne (ASS) affrontent de nombreuses « turbulences ». Celles-ci se nourrissent souvent les unes des autres, s’enchevêtrant jusqu’à devenir inextricables, et leurs liens multiformes rendent très difficile l’identification des modalités par lesquelles elles pourraient être supprimées ou circonscrites. On pourrait toutefois les classer en deux catégories : celles présentes depuis des décennies ; celles apparues plus récemment mais tout aussi perverses.
Cinq principales turbulences sont des compagnes de route habituelles de l’ASS.
La première est la faiblesse de la croissance moyenne annuelle du Produit Intérieur Brut (PIB) des pays qui la composent. Depuis les années 1960, celui-ci n’a connu que deux phases favorables, celle de 1960/75 et, surtout, celle de 1995/2015, durant lesquelles la hausse de cet indicateur a atteint en moyenne 5%/an. Hors ces périodes, ces PIB n’ont cru que modestement, et en tout cas de façon sensiblement inférieure à celle des pays en développement d’Asie et d’Amérique Latine, et parfois même régressé à certains moments. Les 4% de hausse annoncés pour 2021 sont le meilleur score obtenu depuis 2015, mais l’embellie risque d’être remise en cause en 2022 par les effets des évènements d’Ukraine. Cette moyenne peu satisfaisante occulte toutefois un changement majeur : l’Afrique devient aujourd’hui de plus en plus multiple, et quelques pays réalisent régulièrement des progressions à hauteur des meilleures performances mondiales. Ainsi, Ethiopie, Kenya, Tanzanie, Ghana approchent souvent des taux annuels de 8%. Le PIB de l’Union Economique et Monétaire (UEMOA) progresse de près de 6%/an depuis 10 ans. Malgré tout, les difficultés des pays les plus puissants -Nigéria, Afrique du Sud, Angola- handicapent toujours l’évolution d’ensemble de l’ASS et brouillent l’image du continent. Ces performances globales médiocres résultent de trois principaux facteurs : la prédominance persistante de la production de matières premières exportées (pétrole, minerais ou cutures de rente) dans les moteurs de la croissance, qui corrèle étroitement celle-ci aux cours mondiaux de ces produits ; la lenteur des réformes structurelles et notamment l’accroissement insuffisant des activités de transformation qui autoriseraient une réduction de la dépendance économique ; l’insuffisance, et souvent l’inadaptation, de financements pour réaliser les investissements nécessaires.
Un deuxième écueil est que cette hausse modérée du PIB des économies africaines a été absorbée en grande partie par la croissance démographique. En ce domaine, et contrairement à la sphère économique, l’Afrique est restée plus homogène, mais est désormais un monde à part. Sa spécificité s’exprime notamment par deux indicateurs globaux : un taux de fertilité (nombre d’enfants par femme) encore supérieur à 4 alors qu’il est descendu aux environs de 2 dans toutes les autres régions du monde, hormis l’Asie du Centre et du Sud ; une augmentation annuelle de la population comprise entre 2,5% et 3%/an, contre moins de 1% ailleurs. L’historique des dernières décennies montre certes une tendance, récente et variable selon les pays mais globalement encore faible, vers un rapprochement avec les autres continents. Le taux de fécondité s’est ainsi replié à 4,4 en Côte d’Ivoire et même à 3,3 au Kenya, mais est encore à 5,5 au Mali et 4,7 en Tanzanie. Au Niger, où il est un des plus élevés au monde, il atteint 6, faisant plus que doubler la population de 11 à 25 millions d’habitants entre 2000 et 2022. Les obstacles à la baisse sont à la fois économiques, religieux, historiques, sociologiques. Ils expliquent la lenteur de cette évolution et les difficultés pour les dirigeants de l’accélérer. Cette expansion démographique, jointe au ralentissement de la croissance depuis 2016, explique que le revenu par tête n’ait guère progressé depuis 5 ans. Même avec une hausse annuelle du PIB global de 5,5%, il faudrait une génération pour que le revenu par habitant double, toutes choses égales par ailleurs. D’autres marqueurs démographiques confirment le retard du continent, tels les taux élevés de mortalité infantile ou maternelle, ou le nombre toujours important de mariages précoces. L’inertie inhérente aux variables démographiques fait aussi que ces handicaps actuels devraient se maintenir au moins dans les 30 prochaines années.
La conjonction de ces deux premières turbulences en génère une troisième : la stagnation du taux de pauvreté absolue dans la plupart des pays africains à des niveaux proches de 40% de la population, loin des 10% atteints en Amérique Latine ou en Asie. Malgré des variantes entre pays, cette pauvreté s’impose au regard dans toutes les capitales et, encore plus, à l’intérieur des pays. Plusieurs causes s’associent pour expliquer cet état de fait : la faiblesse de la croissance ; la modestie d’une politique de redistribution par les Etats ; les bas niveaux de salaire dans l’informel et l’agriculture qui apportent la grande majorité des emplois. Cette pauvreté est en retour un frein à l’accélération de la croissance, un risque croissant d’explosion sociale, un nutriment de la manipulation des masses par des décideurs défaillants, une incitation à l’émigration quels qu’en soient les risques physiques ou sociaux, une publicité pour l’enrôlement dans le terrorisme. Elle illustre aussi que l’ASS s’éloigne le plus du premier des 17 nouveaux Objectifs du Développement Durable (ODD) retenus par les Nations Unies, et rend encore plus difficile les respect de tous les autres. Sans mutation profonde et à bref délai, la pauvreté absolue (moins de 1,9 USD/jour actuellement) toucherait près de 800 millions de personnes en 2050 quand l’Afrique comptera 2 milliards d’habitants. L’essor escompté d’une classe moyenne est apparu un temps, dans la parenthèse afro-optimiste, la piste capable de faire basculer une part importante de la population hors de la pauvreté. Une décennie plus tard, cette possibilité apparait limitée dans son ampleur et cantonnée à une minorité de pays, dans chacune des régions de l’ASS.
Comme la pauvreté, les questions liées à l’éducation et la formation sont à la fois cause et conséquence des difficultés du développement économique. D’importants progrès ont été accomplis depuis les indépendances, notamment sur le plan quantitatif et dans l’enseignement primaire. Mais de grands chantiers sont à accélérer pour éliminer des handicaps : étendre les avancées aux enseignements secondaires, supérieurs et, surtout, professionnels ; améliorer la qualité de l’éducation ; mettre un accent particulier sur la formation professionnelle pratique, surtout dans les métiers techniques. Au Mali par exemple, comme dans d’autres Pays Moins Avancés (PMA), les inconvénients s’empilent depuis des années : faible expérience de beaucoup d’enseignants à tous les niveaux de la scolarité, grèves répétées et « bras de fer » avec l’Etat sur des rattrapages salariaux, « années blanches » sans examen, écoles supérieures privées chères et parfois surévaluées. En beaucoup d’endroits, et notamment en territoires musulmans, le pourcentage des filles scolarisées est aussi nettement inférieur à celui des garçons, privant les pays d’une part notable de leurs ressources humaines. Jointe au poids élevé de la population en âge de scolarisation et à la rareté des emplois formels, cette situation rend le « dividende démographique » illusoire, surtout dans les pays où la population progresse le plus vite.
Enfin, le manque d’infrastructures est un ultime handicap critique au développement. Des améliorations significatives sont constatées après les réalisations des « 10 glorieuses » de la période 2005/2015. Mais elles suffisent d’autant moins que les retards étaient considérables, que ces investissements ont privilégié certaines composantes -comme des routes et des voies urbaines-. Le secteur de l’énergie est ici un des domaines où les manques sont les plus criards et compromettent le plus les changements nécessaires. Il est marqué notamment par l’insuffisance des nouveaux investissements, la priorité longtemps donnée aux énergies non renouvelables, parfois les plus polluantes, aux dépens par exemple d’une énergie solaire immensément disponible, les coûts élevés pour les usagers, le mauvais fonctionnement des sociétés étatiques gestionnaires qui pénalise le bon fonctionnement des équipements et génère de coûteux délestages. Les améliorations sont cependant possibles comme le montrent les investissements conséquents réalisés par certains pays au profit du solaire, tels le Kenya, le Sénégal ou le Burkina Faso. Une nouvelle fois, l’accroissement de population peut réduire à néant les efforts puisque le nombre de personnes non desservies croît, même si leur pourcentage dans la population totale diminue. Dans ce chapitre des infrastructures souvent à haute intensité capitalistique, et donc exigeantes en ressources financières et techniques, l’énormité des chiffres évoquant les gaps à combler, qui vont de 50 à 100 milliards d’USD/an selon les sources, a fini d’émouvoir.
A ces obstacles, identifiés de longue date mais toujours présents, sont venus se greffer dans la dernière décennie trois autres turbulences.
La première est l’exacerbation d’insécurités dans tous les aspects du quotidien. La manifestation la plus connue en est la « mauvaise gouvernance » politique, largement répandue, qui anéantit la protection normalement apportée aux populations et aux entreprises par les Pouvoirs Publics. Elle exprime à la fois le non-respect par les dirigeants des règles qu’ils sont normalement chargés d’appliquer, le refus ou l’incapacité de servir l’intérêt général, parfois la restriction de la liberté d’expression ou d’information, la prévalence de la corruption, le libre cours à la désinformation. Au plan physique et patrimonial, l’insécurité s’illustre par la montée et l’expansion géographique du terrorisme et du grand banditisme, sans que les Etats, leurs armées et leurs administrations sachent les éradiquer. La dégradation de services publics comme la santé, l’éducation et la justice, préoccupations prioritaires des citoyens, conséquence directe des turbulences anciennes, ne fait qu’amplifier ce mouvement. Dans le domaine économico-social, cette insécurité s’exprime aussi par divers canaux, tous plus dirimants les uns que les autres : les abus fiscaux sur l’économie formelle, les dénis de justice, les appels d’offres virtuels, parfois même la destruction de biens par l’Etat, l’irrégularité de la fourniture d’une électricité souvent très coûteuse pour de nombreuses entreprises. Le dérèglement climatique, dont les effets sont apparus en nombre de pays, s’inscrit maintenant dans cette liste, comme l’ont montré les récents exemples des nouvelles sécheresses en Afrique de l’Est et des grandes inondations en Afrique du Sud. La décomposition des valeurs morales, dans des sociétés où l’argent facilement et rapidement gagné devient souvent pour la jeunesse le critère de réussite, introduit une nouvelle forme d’insécurité et un sentiment d’injustice pour les plus méritants. Enfin, les faiblesses de beaucoup d’appareils statistiques rendent incertaines les données collectées et peuvent compromettre la valeur des appréciations et des politiques : les modifications brutales de certains PIB nationaux en témoignent.
La seconde, peut-être la plus grave, provient des risques de « déconstruction » régionale. La constitution d’Unions de pays voisins est longtemps apparue comme une des meilleures manières d’accélérer et de consolider la croissance économique et de la répartir plus équitablement. Dans certains secteurs, des avancées notables ont été obtenues grâce à cette mutualisation des moyens financiers et humains et à la volonté collective de dirigeants unis au service d’objectifs communs : en Afrique de l’Ouest, la construction de barrages ou le redressement des banques illustrent ces succès. De manière globale, l’Union Economique Ouest Africaine (UEMOA) ou l’East African Community (EAC) sont souvent présentées comme faisant partie des meilleures références en la matière. Elles ont à leur actif quelques belles réussites grâce à leur intégration économique et financière bien avancée, et les bons résultats des économies qui les composent ne peuvent être indépendants de cette situation. La récente adhésion de la République Démocratique du Congo à l’EAC prouve que des regroupements d’Etats peuvent encore apparaitre comme une solution pour gagner du temps sur le chemin de la stabilité politique et de la croissance économique. Pourtant, la dernière décennie manque de grandes nouveautés en ce domaine. L’intérêt porté à ces rassemblements semble aussi passé de mode : le dernier rapport « Africa Pulse » de la Banque Mondiale ne dit rien de ces Unions régionales. Surtout, des évènements intervenus dans les deux dernières années tendent à montrer que des dirigeants privilégient durablement des préoccupations nationales à la discipline requise au sein d’un regroupement de nations. Les relations de la CEDEAO et de l’UEMOA avec le Mali depuis les deux coups d’Etats de 2020 et 2021 sont le cas actuellement le plus grave de cette déconstruction. Elles ont sérieusement perturbé le fonctionnement de l’économie malienne : le blocage des frontières réduit les possibilités d’importation et d’exportation du pays, élève les coûts et réduit les investissements, nationaux comme étrangers ; l’interdiction des transactions financières avec les autres pays de l’Union perturbe les circuits financiers des entreprises, des ménages mais aussi de l’Etat. Les menaces s’accumulent : arrêt des financements des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) suite aux non-remboursements de l’Etat ; cri d’alarme des banques sur les impayés de la dette publique malienne. Le motif avancé du côté malien d’une « refondation », qui tarde à prendre forme, provoque l’absence de visibilité sur la sortie de cette impasse. Ce retard risque de créer des dommages difficiles à réparer et une tentation pour Bamako de rechercher ailleurs des solutions durables, même si elles ne sont pas optimales pour le pays. La CEDEAO et l’UEMOA ne sortiraient pas non plus indemnes de la persistance d’une mise à l’écart du Mali alors qu’une crise de nature avoisinante a déjà saisi la Guinée en 2021 et le Burkina-Faso début 2022. Si cet isolement frappe aussi le Burkina,, c’est près de 25% du PIB et plus de 30% de la population de l’UEMOA qui seraient ainsi exclus, réduisant d’autant l’audience de l’Union. L’Afrique Centrale francophone, jusqu’ici déjà peu exemplaire en termes d’intégration, voit en outre ses risques politiques croitre pour la succession de certains de ses dirigeants à la longévité exceptionnelle, ou sa cohésion économique compliquée par le récent avatar de la décision de la Centrafrique pour l’adoption du Bitcoin comme monnaie officielle. La solidarité régionale, longtemps espoir d’accélération des mutations, pourrait ainsi s’effilocher, laissant place à la tentation d’un repli sur soi, si elle ne prouve pas au plus vite qu’elle contient tous les ressorts d’une solution optimale.
Enfin, malgré la multiplication des acteurs, la question des financements étrangers génère maintenant une turbulence qui s’amplifie à au moins deux niveaux.
La coordination et l’efficience de ces soutiens d’abord. L’Aide Publique au Développement (APD), celle des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), longtemps prédominante, cohabite désormais avec les apports de plus en plus importants de nouveaux intervenants : pays arabes, puis Chine et autres grands émergents, marchés internationaux de capitaux. Ces financements sont trop rarement coordonnés entre eux, ce qui risque de réduire leur impact global et de générer des compétitions créatrices de surendettement des emprunteurs, particulièrement à une époque où les tensions s’aggravent entre les grandes nations et où chaque camp souhaite utiliser ses concours pour se constituer des alliés. Les conditions d’octroi et de remboursement ne sont pas toutes transparentes et peuvent donc être pénalisantes pour les pays destinataires dont les capacités de négociation sont faibles. Surtout, la pertinence des cibles et des modes d’action nécessite des améliorations. Les apports des partenaires pour des projets reflètent encore trop souvent les objectifs et préoccupations de ceux-ci plutôt que ceux des pays receveurs. Le recours au marché ou aux financements budgétaires est au contraire exempt de contrôles et susceptible de dévoiements par rapport aux priorités. Ce désalignement a conduit dans le passé à de graves impasses, comme le libéralisme excessif de certains PTF qui a mis à mal l’industrialisation dans de nombreux pays. Le second niveau est plus technique et concerne principalement le coût global de ces soutiens. La réduction du poids relatif de l’APD, la moins onéreuse, tend à renchérir le coût total du montant global des dettes extérieures tandis que l’appel au marché place les emprunteurs en risque de taux et de change. D’autres obstacles importants persistent, comme la lenteur de mobilisation des ressources obtenues, et la difficulté pour beaucoup de PTF d’accepter de traiter directement avec des structures plus proches des utilisateurs finals et capables de mieux apprécier les meilleures modalités à utiliser. Indispensables, les financements étrangers ne jouent donc pas pleinement le rôle escompté.
L’Afrique subsaharienne est-elle condamnée à rester en arrière du reste d’un monde en expansion, à cause de ces turbulences, anciennes ou récentes, dont l’enchevêtrement empêche le déblocage ? Elle est pourtant une championne de la résilience, comme l’a montré sa capacité à résister récemment à la pandémie du Covid avec des moyens plus que modestes. Cette vitalité qui s’affiche partout en Afrique ne peut être synonyme de défaite éternelle et nous fait espérer qu’un cycle vertueux de croissance économique et de modernité maîtrisée apparaitra comme il est né ailleurs. Il reste à trouver et mettre en œuvre les bons points d’appui pour faire « bouger les lignes ».
Paul Derreumaux,
Article rédigé le 30/05/2022