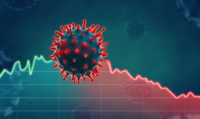Pauvreté aggravée et diversité accrue :
deux impacts majeurs du Covid19 en Afrique
Alors que le monde s’embarque avec inquiétude dans une nouvelle année, les principales institutions internationales se livrent à un exercice difficile qui est aussi un de leurs jeux favoris : celui des prévisions de croissance économique. La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI) ont ainsi actualisé début janvier leurs hypothèses d’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) des grandes régions du monde, tant pour les estimations de l’année 2020 que pour les prévisions de l’exercice 2021. Pour l’Afrique subsaharienne, les chiffres de chacune des deux périodes appellent plusieurs commentaires ou compléments.
Pour 2020, sans surprise, les dernières données retiennent pour cette zone une diminution du PIB d’au moins 3% (jusqu’à -3,7% selon la Banque Mondiale). C’est moins que le recul prévu de 4,9% pour le monde, de 4,2% pour la moyenne des pays de l’OCDE ou de 8,7% pour la France. En somme, l’Afrique subsaharienne ferait mieux que la plupart des grandes régions du monde, Chine mise à part où on attend une croissance du PIB sans doute supérieure à 2%. Ces chiffres sont toujours empreints de beaucoup d’incertitudes. Les principales prévisions pour 2020 établies au début de la pandémie étaient encore nettement plus mauvaises, peut-être par souci de frapper les esprits par leur catastrophisme, et ont été relevées à plusieurs reprises au fur et à mesure qu’étaient constatés les efforts des gouvernements et les capacités d’adaptation des acteurs économiques pour contrer cette crise inédite. De plus, la difficulté de comptabiliser le secteur informel, fort lourd en Afrique et peut-être moins touché par la pandémie, accroit aussi la difficulté de mesurer l’impact final du « choc Covid » sur l’économie de ces pays en 2020.
Si le ralentissement par rapport à 2019 a été général, comme partout dans le monde, la différentiation entre pays a été encore plus marquée dans cette année atypique. Le Nigéria a été victime de la structure de son économie et très pénalisé par l’effondrement des cours du pétrole durant le confinement généralisé du deuxième trimestre 2020, qui s’est ajouté aux effets de la crise sanitaire : son PIB devrait se replier d’environ 4%. En Afrique du Sud, le lourd tribut payé à la pandémie -près de 1,1 million de contaminations fin décembre dernier- a lourdement pesé sur les finances publiques tandis que ses activités minières et industrielles subissaient de plein fouet la baisse de l’activité mondiale. Le recul du PIB en 2020 y est estimé entre 5% et 7,5% selon les hypothèses retenues. A eux seuls, ces deux mastodontes ont joué un grand rôle dans la diminution globale du PIB en zone subsaharienne, mais celle-ci a touché près d’une quarantaine de nations. Quelque dix pays ont pourtant réussi à maintenir une progression de leur PIB, même si celle-ci a toujours été inférieure à 3% : c’est par exemple le cas de l’Egypte, du Kenya, de la Côte d’Ivoire, du Ghana. Dans les regroupements régionaux, l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’en sortirait bien avec un taux de croissance du PIB attendu positif à 0,7%, soutenu par les accroissements de l’ordre de 1% à 2% de cinq pays sur 8, les -2% du Mali étant la plus mauvaise note de cet ensemble. L’impact sanitaire local du Covid-19 souvent assez modéré -hormis en Egypte- a sans doute facilité les choses, mais ces « champions » de la croissance africaine en 2020 ont eu la chance de s’appuyer sur des appareils économiques assez diversifiés, non orientés de manière prédominante vers l’étranger, sur une population nombreuse qui a soutenu notamment des activités agricoles importantes dans la production nationale, avec des politiques publiques dynamiques en termes d’aides aux entreprises et aux ménages, ou d’investissements en infrastructures.
Malgré ces rares performances, la conclusion essentielle de 2020 est la baisse générale du revenu par habitant dans tous les pays subsahariens. Selon les cas, celle-ci sera donc comprise entre 1% et 8%, compte tenu d’une augmentation de population qui reste généralement proche de 3%/an. Ce repli parfois très conséquent est d’autant plus dramatique que l’ensemble de la zone n’a plus dégagé depuis 2016 une progression du PIB supérieure à celle de sa population, à l’exception de quelques pays figurant en particulier parmi ceux qui ont eu les meilleures évolutions en 2020. Le taux de pauvreté absolue, déjà supérieur à 40% et dont le recul était déjà très lent, devrait donc encore faire un bond pendant l’année écoulée. Certaines statistiques évoquent déjà plusieurs dizaines de millions de personnes concernées, mais la situation finale dépendra notamment des politiques compensatoires menées par les Etats, du rôle stabilisateur que jouera le secteur informel et de la rapidité d’une relance économique globale en 2021.
Sur ce plan, les perspectives sont pour l’instant moins bonnes que prévu. Dans leurs prévisions, Banque Mondiale et FMI ont annoncé respectivement pour 2021 en Afrique subsaharienne des hausses de 2,7% et 3,1% du PIB, qui le conduiraient en fin de période à un niveau inférieur à celui de fin 2019. Une évolution du même type vaut d’ailleurs pour la plupart des régions du monde et la prudence peut ici s’expliquer par les inconnues qui persistent pour l’année nouvelle dans la maîtrise de l’épidémie, mais surtout dans le rythme et les contours possibles de la reprise. Sur le continent, ces facteurs de risque sont d’ailleurs nombreux et parfois spécifiques. Au plan sanitaire, même si l’épidémie du Covid-19 reste moins envahissante qu’en Amérique ou en Europe, la faiblesse des équipements de santé, les manques de personnel soignant et de moyens financiers, les retards sans doute importants avec lesquels les vaccins seront délivrés vont continuer à faire peser une menace continue et la possibilité de nouvelles « vagues », en particulier dans les pays les plus pauvres. Au plan sécuritaire, le danger est toujours aussi présent dans certaines parties du Sahel, au Nigéria et quelques pays d’Afrique de l’Est, et l’éradication du terrorisme y apparait très difficile à court terme : ce fléau concerne donc plus de 200 millions de personnes et supprime dans de larges régions les possibilités de développement économique, de réduction de la pauvreté et de présence de l’Etat. Au plan politique, les élections en vue pour 2021 ne devraient pas contribuer au renouveau du personnel politique et certains pays laissent subsister de grandes incertitudes, tel le Mali en « transition ».
En matière économique, les évolutions seront sans doute mitigées. Le continent va d’abord bénéficier d’une reprise économique mondiale : même si sa force et sa généralité sont encore incertaines, elle devrait s’appuyer sur l’atténuation de l’impact du Covid19 dans les grands pays, grâce aux vaccins et à l’évitement des confinements, sur le retour à un fonctionnement normal de la plupart des secteurs (hors ceux des transports aériens et du tourisme international) et la montée en puissance de nouveaux métiers. Cette embellie va soutenir la demande des produits de base et le prix international de ceux-ci, qui composent une partie essentielle des exportations de l’Afrique : le coton, le cacao, l’or, plusieurs métaux suivent déjà cette tendance à des degrés divers. De même, les cours de l’or noir ont environ doublé en 10 mois et atteignent aujourd’hui les 60 USD : ce seuil devrait redonner du souffle aux pays exportateurs de pétrole, et notamment le Nigéria dont la perspective de croissance pourrait être relevée si cette hausse se confirme. Les secteurs qui ont bien traversé la crise de 2020, comme les télécommunications, les entreprises bancaires et financières et les sociétés minières, poursuivront sans doute leur marche en avant, poussée par le meilleur environnement et leur gestion exigeante et réglementée. Les rattrapages de réalisations d’investissements publics en infrastructures, aidés par une intensification des financements correspondants des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), devraient aussi soutenir la croissance du PIB, alimenter l’activité de secteurs fortement créateurs d’emplois, comme les travaux publics, et améliorer l’environnement des entreprises. C’est sur la base de ces éléments que les analystes escomptent le retour d’une croissance du PIB en 2021 dans la quasi-totalité des pays subsahariens. Les pourcentages estimés sont cependant fort variables. Avec seulement 1,1%, la hausse médiocre du Nigéria freine fortement la croissance d’ensemble. Celle-ci est au contraire tirés par des zones comme l’UEMOA, entrainée elle-même par la Cote d’Ivoire mais aussi le Bénin ou le Niger, et l’East African Community (EAC), emmenée par le Kenya et la Tanzanie, où la croissance serait partout supérieure à 5% sur l’année. Le taux d’environ 3,3% attendu pour l’Afrique du Sud se situe dans la moyenne et contribue significativement à l’amélioration générale de la situation.
Deux inconnues importantes peuvent cependant participer à faire basculer les évolutions dans un sens plus favorable ou plus préoccupant. La première est issue de l’accroissement de pauvreté généré par les nombreuses perturbations d’activité et pertes d’emplois nées en 2020 de la crise sanitaire mondiale. L’aggravation est encore difficile à chiffrer et le secteur informel a joué partout son rôle habituel d’amortisseur de crise. Pourtant, il est certain que les revenus de nombreux ménages ont baissé, spécialement pour ceux qui étaient déjà les moins favorisés (travailleurs non qualifiés) et ceux qui travaillaient dans les secteurs les plus touchés (transport, tourisme, hôtellerie, industries,..). Les aides compensatoires déjà financées par les Etats ont été souvent insuffisantes et d’ampleur inégale selon les pays, en fonction de leur vivacité à réagir, de leurs moyens financiers, et de la pertinence de la politique de riposte, et cette diversité risque de se poursuivre. A la baisse des revenus, qui pénalise la consommation, s’ajoutent depuis le début de l’année des hausses de prix notables sur un nombre croissant de produits, notamment importés, qui illustrent la tendance à faire payer les difficultés de 2020 par les consommateurs finals. Si cette inflation ne peut être maitrisée et touche des produits sensibles, elle pourrait provoquer de graves crises sociales là où les Autorités auront le moins bien joué leur mission de redistribution de richesses.
La seconde donnée touche les investissements privés dans les secteurs productifs, indispensables pour accélérer la croissance future et les transformations structurelles nécessaires à la modernisation et la compétitivité de chaque économie. Ceux-ci ne devraient pas retrouver dès 2021 leurs niveaux antérieurs. Dans beaucoup d’entreprises locales, les capacités d’autofinancement ont été réduites, voire asséchées, par les baisses d’activité, et la prudence des banques s’est accrue pour tenir compte de la hausse des risques de crédit provoquée par la crise « Covid-19. Beaucoup de groupes internationaux attendent aussi la relance dans leurs principaux sites d’implantation et une meilleure visibilité sur les perspectives d’Afrique subsaharienne avant d’y réaliser de nouveaux projets. La composante des investissements privés, en particulier dans l’industrie, risque donc d’être modeste en 2021, voire en 2022. Les Etats auront ainsi un rôle essentiel à court terme pour conduire des programmes d’investissements publics assez consistants pour assurer un relais substantiel, d’une part, et mener des politiques économiques bien lisibles et incitatrices pour le secteur privé, national comme étranger, afin de restaurer au plus vite sa confiance, d’autre part.
Face à ces contraintes, les Etats qui montreront la meilleure pertinence de leur vision à long terme et leur gouvernance la plus performante seront une nouvelle fois ceux qui apporteront à leurs citoyens les meilleures chances de progrès économique et social.
Paul Derreumaux
Article rédigé le 24/02/2021