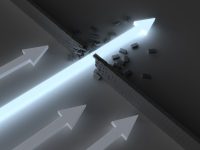Les dernières mutations des banques subsahariennes ont peu développé jusqu’ici leur appétit pour le financement des infrastructures
Depuis la fin des années 1980, les banques commerciales ont réalisé en Afrique subsaharienne d’impressionnantes mutations. Dans la période 2015/2020, ces transformations ont porté principalement sur trois plans.
Au plan capitalistique tout d’abord, le départ des intérêts extérieurs au continent s’est poursuivi. En zone francophone, les banques françaises ont accéléré leur repli. Après Indosuez puis le Crédit Lyonnais dans les années 2000, les Banques Populaires ont laissé leurs implantations en Afrique Centrale en 2018 et la BNP vient de céder trois filiales en Afrique de l’Ouest et négocie des sorties dans d’autres zones. Dans l’espace anglophone, la réorientation de Barclays a conduit au démembrement de sa puissante implantation africaine. Les participations étrangères ont été rachetées pour partie par des établissements marocains, qui prolongent leur expansion géographique, et pour partie par des banques subsahariennes. Ces dernières continuent également leur croissance exogène par de nouvelles implantations. Les groupes Coris Bank, BGFI et Atlantic Financial Group (AFG) sont les plus actifs en zone francophone ; quelques réseaux nigérians, tels celui de UBA ou d’Access Bank, kenyans, comme Equity Bank, ou sud-africains, telle Stanbic, mènent le mouvement en Afrique anglophone. Malgré la résistance d’acteurs comme la Société Générale française, les intérêts africains dominent donc de plus en plus le paysage.
Le durcissement réglementaire est le deuxième changement majeur. Il s’est d’abord longtemps manifesté partout par des exigences régulièrement accrues pour le capital minimum des banques africaines, qui atteint souvent aujourd’hui des niveaux très élevés : 30 millions de USD en République Démocratique du Congo (RDC), environ 90 millions de USD au Ghana ; 190 millions de USD au Nigéria dès 2005 par exemple. Dans l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), ce seuil, même s’il a été multiplié par10 en 10 ans et s’élève désormais à environ 15 millions d’EUR, reste donc encore à la traine. Mais la priorité est de plus en plus donnée à des ratios réglementaires contraignants, qui obligent les banques à ajuster immédiatement leurs fonds propres dans une relation directe avec l’augmentation de leurs risques de crédit ou opérationnels. En effet, reflétant en cela la réglementation internationale, le suivi du risque est devenu progressivement la ligne directrice du contrôle des activités bancaires par les organes de régulation. Dans l’UMOA, cette application de règles inspirées de celles de « Bale III » a été tardive, mais irréversible depuis 2018 et s’étale sur 5 ans. Malgré sa sévérité par rapport aux normes précédemment en vigueur, cette réforme semble d’ailleurs jusqu’ici assez bien supportée par la majorité des banques, ce qui montre leur capacité d’adaptation et leur bonne santé financière d’ensemble. Mais déjà, dans des pays économiquement plus matures comme le Maroc, s’installent les dispositions de « Bâle IV » qui s’étendront inévitablement ailleurs.
L’importance grandissante de la digitalisation est la troisième et plus récente mutation en cours. La plupart des banques ont pris un important retard en la matière, pénalisées par des systèmes informatiques mal conçus pour intégrer de tels changements, par les coûts importants liés à cette mutation et, peut-être, par une trop grande confiance dans leur supériorité. Les succès commerciaux impressionnants du « mobile banking », la concurrence frontale des banques sur le terrain des moyens de paiement engagée par les sociétés de télécommunications, avec la création d’Emetteurs de Monnaie Electronique (EME), et les changements des habitudes des clients, de plus en plus addictifs à internet et aux réseaux sociaux, contraignent maintenant les systèmes bancaires à adopter dans l’urgence ces nouveaux moyens de communication et de relations avec leur clientèle. Même si des groupes majeurs comme Ecobank, la Société Générale ou Equity Bank figurent parmi les mieux avancés, des banques encore isolées, telle l’ivoirienne Bridge Bank, sont aussi devenues opérationnelles en ce domaine en 2020 (1).
Ainsi plus africaines dans leurs actionnaires, plus solides dans leurs moyens d’action et leurs structures, plus performantes dans leurs outils commerciaux, les banques subsahariennes demeurent aussi en bonne santé financière. La croissance économique soutenue, au moins jusqu’en 2016, la densification des réseaux d’agences et l’accroissement des ressources collectées qu’elle favorise sont deux des éléments moteurs de ces bons résultats. Ces améliorations ont permis aux systèmes bancaires nationaux de mieux prendre en charge les attentes de financement de leurs pays. Mais ces progrès ont été inégaux selon les secteurs et les types de concours, et le financement des infrastructures est sans doute, avec celui des petites et moyennes entreprises, un des parents pauvres de l’évolution, malgré les besoins considérables en ce domaine souvent évalués à près de 100 milliards de USD/an pour le continent.
Ces besoins peuvent être regroupés en deux principales catégories « stricto sensu ». La première est celle des infrastructures qui dépendent directement ou indirectement de l’Etat et construisent le cadre dans lequel agissent les agents économiques : routes, ports, aéroports, télécommunications, énergie, …. Par leur rentabilité diffuse et souvent difficilement cernable – à l’exception notable des télécommunications mobiles -, par leur montant unitaire souvent considérable, ces investissements sont généralement assumés directement par les Etats ou des sociétés publiques, tant pour leur autofinancement que pour la mobilisation des prêts nécessaires. Toutefois, les banques commerciales sont progressivement associées aux montages utilisés, comme le montrent les trois exemples suivants. Les banques sont d’abord les principaux souscripteurs des titres obligataires émis par les Etats, qui constituent désormais un des instruments les plus courants de mobilisation de ressources locales utilisés par ceux-ci. Elles participent donc par ce biais aux investissements d’infrastructure réalisés au moins partiellement avec ces émissions de bons. Dans les pays francophones, venus plus récemment à ce système, les banques ont vite montré un appétit important pour ces obligations étatiques peu risquées et bien rémunérées, malgré les mesures prises à partir de 2017 par les Autorités monétaires pour limiter cette tendance. La propension des Etats à utiliser au profit de leurs dépenses courantes les ressources ainsi captées réduit cependant l’affectation réelle de celles-ci aux investissements d’infrastructure. Une modalité plus innovante est issue du financement par le Partenariat Public Privé (PPP), dans lequel les banques africaines peuvent s’associer à d’autres acteurs -banques étrangères, Partenaires Techniques et Financiers (PTF) – pour financer pour le compte d’un Etat des infrastructures de grande taille, gérés pour une période donnée par un opérateur expérimenté. Souvent cités, les PPP ont permis de concrétiser en effet certains projets, notamment dans les pays anglophones tel le gigantesque parc éolien du lac Turkana au Kenya avec le leadership de la sudafricaine Nedbank. Dans les pays francophones, les réussites, plus rares et plus modestes, existent aussi comme le projet Albatros d’énergie solaire au Mali. Toutefois, ces exemples tiennent une place encore limitée. La santé financière souvent fragile des entreprises publiques concernées par ces infrastructures, les incertitudes sur les modalités de remboursement par les Etats ou par les paiements des usagers expliquent entre autres cette faible présence. Sur ce dernier point, la diminution d’échelle induite par les nouvelles technologies, notamment pour certaines ressources énergétiques, pourraient améliorer la donne. On pourrait enfin citer d’autres modalités prometteuses, comme celles de la BOAD (2) qui associe certaines banques locales à des prêts qu’elle accorde à des entreprises de travaux publics pour la construction de routes.
La seconde catégorie est celle des investissements en matière de logements. L’Afrique subsaharienne souffre d’un déficit considérable et en accroissement régulier d’habitations décentes sous l’impact de la forte pression démographique et de la poussée de l’urbanisation. Les investissements dans ce secteur, et surtout dans le logement social et économique, ont en effet longtemps souffert de nombreux handicaps : distorsions entre les coûts de viabilisation et de construction, d’une part, et les ressources financières des ménages concernés, d’autre part ; difficultés pour beaucoup d’Etats de prendre en charge les viabilisations de terrains et/ou les subventions aux programmes de constructions ; fiabilité insuffisante de nombreux promoteurs ; disparition progressive des banques étatiques spécialisées ; manque de ressources longues des banques commerciales pour des prêts acquéreurs ; ratios prudentiels très contraignants. Ces trois derniers points expliquent que les systèmes bancaires n’aient pu faire de ce créneau une composante importante de leur portefeuille, à la différence par exemple du Maroc où le financement du logement a été dans les années 1990 une des causes notables de l’essor magistral des grands établissements marocains avec l’appui des Autorités politiques et monétaires. Les blocages inhérents aux institutions bancaires se sont peu à peu desserrés depuis le début des années 2010. Grâce à la forte croissance des ressources collectées et aux efforts commerciaux et organisationnels des banques, la durée moyenne des dépôts s’est notablement allongée, facilitant l’octroi des crédits immobiliers à long terme. Dans certaines zones monétaires, des contraintes réglementaires ont été assouplies : ainsi, dans l’UEMOA, le ratio de transformation a été abaissé en 2015 à 50%, contre 75% auparavant, et le secteur immobilier est favorisé en termes d’exigences de fonds propres pour les banques dans les mutations introduites en 2018 par la réforme dite de « Bâle II/III ». Dans cette même Union, suivant en cela d’autres pays du continent, une Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) offre depuis 2010 des possibilités de refinancement à long terme pour les concours à l’habitat, soit par des ressources drainées sur le marché régional, soit plus récemment par des concours à conditions concessionnelles obtenues de certains PTF. Malgré cet environnement plus positif, les crédits acquéreurs ne progressent encore que modérément. La gestion foncière souvent médiocre des Etats, la faiblesse des revenus moyens des particuliers, les taux d’intérêts encore trop hauts, freinent en effet l’évolution souhaitée. Celle-ci, pour être stimulée, aura besoin d’idées nouvelles. En la matière, le succès en 2019 de l’emprunt obligataire de 20 milliards de FCFA par la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) placé auprès de la diaspora du pays, pour de nouveaux programmes promus par cette banque, est une première subsaharienne et ouvre des perspectives encourageantes.
Malgré de meilleurs atouts, les banques subsahariennes se sont donc pour l’instant peu tournées vers le financement des infrastructures. Pour amplifier les améliorations constatées, il sera indispensable que les autres acteurs concernés contribuent activement à améliorer l’environnement de ces investissements. Sous ces conditions, une hausse moyenne des actifs bancaires à hauteur de 1% du PIB du continent, qui génèrerait quelque 10 milliards de USD de crédits à moyen et long terme, pourrait voir une part significative de ceux-ci orientée vers les infrastructures.
- 1. D’autres évolutions attendues (Revue Banque mai 2013 : La banque saharienne du futur : quelques mariages, beaucoup d’innovations) n’ont pas pleinement prospéré
- 2. Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Article paru dans le mensuel Banque & Stratégie publié par le Groupe Revue Banque.
Retrouvez l’article dans le numéro 395 d’octobre 2020 « Financement des infrastructures en Afrique » http://www.revue-banque.fr/banque-strategie/numero-395
Paul Derreumaux